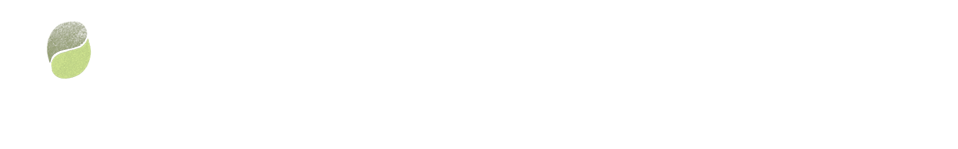

399 hits
Jena Webb, Directrice des programmes, CoPEH-Canada
le 20 octobre 2022
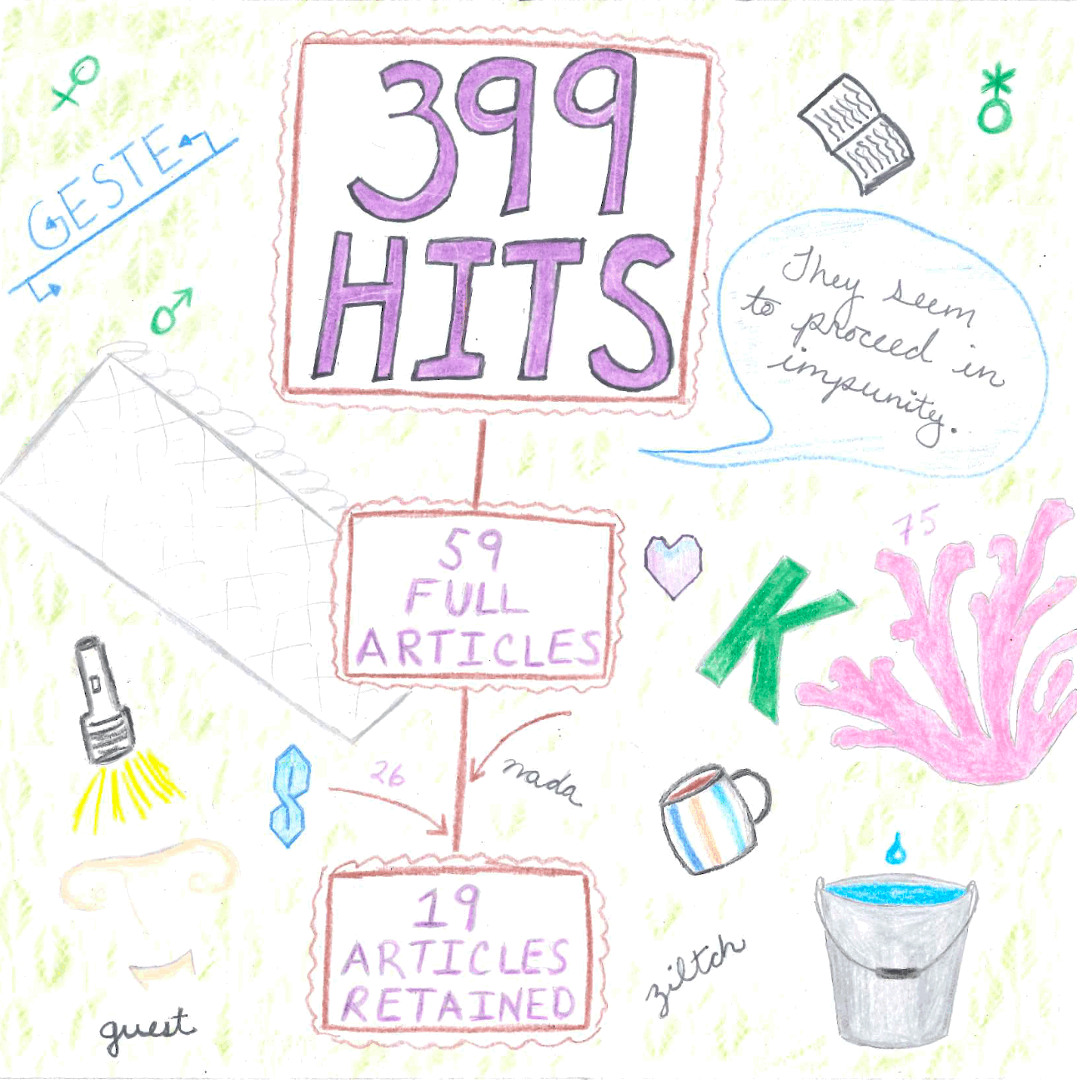
Récemment, j’ai participé, en tant que représentante de CoPEH-Canada, à un projet avec l’équipe GESTE (Genre, équité, santé, travail, environnement) financée par les IRSC. Ce projet visait à découvrir, à décrire et à systématiser les meilleures pratiques d'intégration du sexe et du genre (s/g) dans les projets d'application des connaissances intégrées (iKT), et ce, dans les domaines de la santé au travail et de la santé environnementale. Parmi les autres activités de recherche, nous avons notamment fait une évaluation de la prise en compte du sexe et du genre dans l’application des connaissances dans des projets de recherche en santé environnementale à la suite de notre formation hybride de 2018 (Vansteenkiste, Saint-Charles, Fillion, 2019). J’ai aussi participé à une revue de la portée de la littérature scientifique et de la littérature grise qui décrit de telles pratiques. Après avoir éliminé les doublons d'une deuxième recherche dans les bases de données scientifiques, il nous restait 399 ‘hits’. Ce billet décrit mon cheminement personnel lors du tri de ces 399 articles.

En lisant les 399 résumé, j'ai été frappée, encore et encore, par les multiples injustices vécues principalement par les femmes et les personnes non binaires. À mi-chemin – dans les K –, j’ai pris connaissance du système mis en place par l'Union européenne pour décharger le contrôle des réfugiés au Maroc et de la violence sexuelle que les hommes responsables des points de contrôle infligent aux femmes réfugiées (Keygnaert, et al. 2014). Après 75 pages de résumés sur la mobilisation des connaissances dans les études sur la santé, l’équité et le genre, je suis tombé sur la première phrase qui remontait aux racines de l'injustice : « Ils [les hommes responsables des points de contrôle] semblent procéder en toute impunité ».
Ils semblent procéder en toute impunité.
Une phrase si courte. Avec tant de sens. Enfin, l'accent n'était plus mis sur la victime, mais sur l'auteur du crime. Enfin. Néanmoins, comme on le fait dans le milieu universitaire, cela a été fait humblement et en prenant de grandes précautions : « Ils semblent procéder en toute impunité ».
Plus tard, alors que je lisais intégralement les articles que nous avions retenus de la deuxième sélection (n=59), j'ai commencé – dans les S – le seul article complet qui traitait explicitement de la santé des hommes. Il s’agissait d’un article sur les expériences des hommes afro-américains face au cancer de la prostate. J'y ai lu que l'un des thèmes communs de soutien à ces hommes était les femmes dans leurs vies (Schoenfeld et Francis, 2016). Je venais de terminer la lecture de 26 articles sur la santé des femmes et aucun d'entre eux n'indiquait que les hommes faisant partie de leurs vies étaient un facteur de soutien. Et là, l'une de leurs trois principales conclusions était que pour atteindre les hommes, il fallait passer par les femmes.
Incroyable.
Travailler avec les femmes afin d'atteindre les hommes est l'une des solutions les plus recommandées dans ce document. Ils notent que les informateurs ont affirmé à plusieurs reprises que « les femmes [sont celles qui] parlent de soins préventifs [...]. Nous racontons tout, vous savez [...] et on partage tout ». De plus, « [les femmes sont] celles qui poussent leurs maris à prendre des rendez-vous et ainsi de suite » (Schoenfeld et Francis, 2016, p11).
Ici, les implications sont de deux ordres. Premièrement, les femmes dans les études de cette revue de la portée avaient leurs propres problèmes de santé résultant, dans certains cas, d'inégalités sociétales commencées, du moins, sur ordre du patriarcat ; et entre temps, dans cet exemple, elles devaient assumer la responsabilité des problèmes de santé des hommes aussi.
Deuxièmement, où étaient les hommes dans les 26 articles complets que j'ai lus ? Beaucoup de ces articles portaient sur le cancer du col de l'utérus ou du sein. Pourquoi l'une des principales conclusions n'était-elle pas que les hommes constituaient une structure de soutien dans les stratégies proactives de santé ou de guérison des femmes? Pas un mot à ce sujet. Nada, ziltch. Peut-être que la question n'a pas été posée, ce qui en soi est révélateur, mais dans au moins un cas, le contraire a été constaté.
Cet échantillon de 399 articles portant sur la santé, l’équité et le genre témoignait d’une sorte de masculinité toxique : soit l’auteur, soit l'absent.
Atterrée.
Un autre moment...Parmi combien de moments ? J'en suis désormais à 5 articles près de terminer le processus de sélection d’articles à retenir. Je suis en train de lire sur le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les immigrantes latines. Je vois la ligne d'arrivée. Je la vois. Ce matin, sans doute d’ici un ou deux cafés, j'aurai terminé le processus de sélection. Et je tombe sur cette phrase : "les promotoras ont identifié les attitudes masculines comme un obstacle au dépistage" (Gregg et al. 2010). Mes réflexions sur le fait que les femmes sont le principal facteur de soutien dans le processus de dépistage du cancer de la prostate chez les hommes se répercutent et volent en éclats. J'avais ressenti, lors de la lecture des articles, un "poids" en imaginant les hommes soit comme étant la cause première du problème de santé basé sur l’iniquité (par exemple la violence contre les femmes) ou au mieux – lorsqu'ils n'étaient pas à blâmer –, comme étant neutres (c'est-à-dire fondamentalement absents). Mais voilà que j'apprenais que même lorsqu'ils auraient très bien pu jouer un rôle similaire à celui des femmes dans l'étude sur le cancer de la prostate – celui de soutien – les hommes représentaient plutôt une barrière ; une obstruction dangereuse. Un processus de disempowerment.

Credit: Wise Hok Wai Lum. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
« Une tranche de vérité » (terme utilisé par Gregg et al., 2010).
Certes, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate sont loin d'être analogues. Le cancer du col de l'utérus peut mettre en lumière l'infidélité dans un couple, le rendant propice à la naissance de conflits, alors que le cancer de la prostate n'est pas lié à des questions litigieuses et peut donc inversement être à l’origine d’un moment rassembleur.
Mais qu'en est-il du cancer du sein, alors ?
Ces « 399 hits » ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan en comparaison aux incessants revers, injustices et gifles infligés aux femmes chaque jour depuis des milliers d'années. 399 coups d'un mal incalculable.
Le temps...Est-ce que le temps guérit toutes les blessures? Non, ceci est un adage de privilégié. La majorité du monde, à peine sortie de leur précédente épreuve, subit déjà la prochain coup. J'ai lu ces articles dans le confort sécuritaire de mon foyer, au cours d’une pandémie durant laquelle j'ai pu continuer à travailler. J'ai passé à travers le processus de sélection des articles. J'en suis au dernier des 19 articles retenus et je fais présentement l'extraction des données. Je cherche une voie à suivre ; comment puis-je non seulement être témoin de cette agression, mais en être un agent, un agent authentique ? Et je reçois ces mots de Nina Wallerstein, une chercheuse blanche de classe moyenne issue d'un milieu universitaire:
- « J'ai commencé à me demander comment je pouvais travailler en tant qu'invitée sur cette terre. Cette perception m'a permis de rester moi-même ; de dire, voilà ce que je peux offrir, voilà les compétences que j'ai, et de chercher à être une bonne invitée... alors là seulement, je peux travailler avec intégrité. » (Muhammad et al., 2015)
Nous pouvons tous - hommes, femmes, personnes non binaires - être des invités dans les réalités des autres. La posture d'un invité, me semble-t-il, est celle de la modestie, de la gratitude et de l'attention.
Pour une liste complète des 19 articles retenus, voir :
Références
Gregg, J., L. Centurion, J. Maldonado, R. Aguillon, R. Celaya-Alston et S. Farquhar (2010). "Interpretations of interpretations: combining community-based participatory research and interpretive inquiry to improve health." Progress in community health partnerships : research, education, and action 4(2): 149-154.
Keygnaert, I. Dialmy, A., Manço, A. Keygnaert, J., Vettenburg, N., Roelens, K., et Temmerman, M. (2014). "Sexual violence and sub-Saharan migrants in Morocco: a community-based participatory assessment using respondent driven sampling." Globalization and health 10: 32.
Muhammad, M., N. Wallerstein, A. L. Sussman, M. Avila, L. Belone et B. Duran (2015). "Reflections on Researcher Identity and Power: The Impact of Positionality on Community Based Participatory Research (CBPR) Processes and Outcomes." Critical sociology 41(7-8): 1045-1063.
Schoenfeld, E. R. et L. E. Francis (2016). "Word on the Street." American Journal of Men's Health 10(5): 377-388.
Vansteenkiste, Jennifer, Saint-Charles, Johanne, Fillion, Myriam. Évaluation de la prise en compte du sexe et du genre dans l’application des connaissances dans des projets de recherche en santé environnementale à la suite d’une formation. Dans : conference proceedings Le 89e Congrès de l'Acfas; 2019.